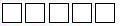|
| Diaphana Distribution |
Lynne Ramsay adapte façon puzzle le roman épistolaire de Lionel Shriver. Le récit fait des allers retours constants entre le passé et le présent, révélant au compte-gouttes les raisons qui ont amené Eva (Tilda Swinton, absolument parfaite) à être ostracisée par son voisinage. On devine rapidement une explication effroyable mais le voile reste épais quant à sa nature même. Dès les premières scènes, Ramsay installe le malaise. Lorsqu'elle plonge sa caméra dans une bataille de tomates géante - une fête populaire espagnole- d'une beauté aussi sidérante que perturbante, elle annonce la couleur : rouge. Une couleur qui ponctue le film comme un leitmotiv, motif balourd qui annonce l'horreur du drame autour duquel se noue l'intrigue. Ce symbolisme sans subtilité, pompier, est l'un des gros point faible du film. Ce qui est plus réussi, c'est la tension croissante que provoque la relation mère-fils qui est décrite. Le Kevin au sujet duquel le titre suggère d'avoir une discussion est une publicité ambulante pour la contraception, l'enfant poison devenant un adolescent monstrueux. Dire qu'il s'agit d'une relation amour/haine est trop simpliste et serait trop confortable. Le film ne se risque pas à dire pourquoi Eva aime son fils coûte que coûte : se force-t-elle au nom d'un prétendu instinct maternel ? par convention sociale ? ou, et c'est peut-être cela qui est le perturbant, parce qu'elle se reconnaît en lui ? Ramsay joue des correspondances entre les plans (des visages immergés, la façon particulière de préparer un sandwich ou de trier méthodiquement des rognures d'ongles/des morceaux de coquilles d'oeufs...) pour signifier leurs ressemblances et nous dire que si tout semble les opposer, ils ont beaucoup en commun. Lorsque le voile se lève enfin sur le drame charnière qui a fait basculer la vie d'Eva (et de Kevin), de multiples questions viennent à l'esprit. Des interrogations qui nous poursuivent longtemps après avoir quitté la salle.
L'Apollonide, de Bertrand Bonello
 Bonello signe un film au charme vénéneux, très bien documenté, et qui, au naturalisme, préfère l'onirisme et son évanescence justifiant le sous-titre "souvenirs de la maison close". Porté par un casting féminin impeccable, ce film d'époque rompt avec les règles de l'académisme pour laisser surgir la modernité de manière assez audacieuse, osant l'anachronisme avec son générique et l'emploi de "Bad girl" de Lee Moses dans la B.O. Bertrand Bonello ne condamne ni ne loue les maisons de tolérance, il ne juge aucunement ces filles mais le regard qu'il porte sur elles redonne leur humanité à ces "objets de désirs". Sa mise en scène s'attache à construire un oxymore, faisant se côtoyer l'effroyable et le sublime, l'innocence et la perversion, l'opulence (des salons et des chambres) et la pauvre condition de ces filles "de joie". L'Apollonide contient ainsi quelques une des plus fortes images que vous verrez au cinéma cette année. Une grande réussite.
Bonello signe un film au charme vénéneux, très bien documenté, et qui, au naturalisme, préfère l'onirisme et son évanescence justifiant le sous-titre "souvenirs de la maison close". Porté par un casting féminin impeccable, ce film d'époque rompt avec les règles de l'académisme pour laisser surgir la modernité de manière assez audacieuse, osant l'anachronisme avec son générique et l'emploi de "Bad girl" de Lee Moses dans la B.O. Bertrand Bonello ne condamne ni ne loue les maisons de tolérance, il ne juge aucunement ces filles mais le regard qu'il porte sur elles redonne leur humanité à ces "objets de désirs". Sa mise en scène s'attache à construire un oxymore, faisant se côtoyer l'effroyable et le sublime, l'innocence et la perversion, l'opulence (des salons et des chambres) et la pauvre condition de ces filles "de joie". L'Apollonide contient ainsi quelques une des plus fortes images que vous verrez au cinéma cette année. Une grande réussite.Restless, de Gus Van Sant
Une jeune fille condamnée par la maladie, un jeune homme fasciné par la mort. C'est le duo, sur le point de devenir un couple, que l'on retrouve à 'affiche de Restless. Sortez les mouchoirs ? Pas si vite ! Parce que le dernier GVS, film de commande produit par Ron -le tâcheron- Howard est assez pauvre en émotions. Henry Hopper, belle révélation, est certes touchant dans son rôle d'ado lunaire et torturé qui rappelle le Harold d'Hal Ashby. Mais Restless tombe dans le piège de la poésie de papier glacé, se parant des atours du romantisme sans fouiller les âmes en profondeur. Ce qui peut amener le spectateur à se concentrer plus volontiers sur les jolies tenues de Mia Wasikowska que sur le destin de ces jeunes personnages.